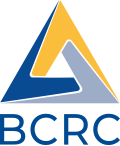Nouvelles de l'université

Futur étudiantPrix, bourses et distinctions
L'équipe Mons'tellaire de la Faculté Polytechnique remporte la coupe de Belgique de robotique
22 avril 2024
L’équipe Mons’tellaire de la Faculté Polytechnique de Mons - UMONS vient de remporter la coupe de Belgique de robotique lors de la compétition…

EnseignementFutur étudiantInstitution
Décret Paysage : les Rectrices et Recteur souhaitent la sérénité dans la transition
19 avril 2024
Les récentes discussions au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles destinées à amender le Décret Paysage, ont suscité une nouve…

PartenariatsRecherche
L’UMONS et EpiCURA lancent la Chaire Innovation Santé
18 avril 2024
Partenaires depuis 2016, l’UMONS et le Centre Hospitalier EpiCURA ont intensifié leur collaboration en lançant officiellement le 12 avril une …
L'UMONS en quelques données clés
-
1500Enseignants, Scientifiques, Chercheurs et agents techniques et administratifsL’UMONS en bref
-
11.000Etudiants7 Facultés et 3 Ecoles
-
1000Chercheurs10 Instituts de Recherche
-
> 150Formations universitaires du Bachelier au DoctoratL'offre de formations
Bien + qu'une
Université

Agenda & événements
Aujourd'hui
- 26 avr. 2023
- 07 oct. 2023
Explorer l’Invisible – 3e édition
Exposition - 08 nov. 2023
- 01 janv. 2024
- 13 mars 2024
Bientôt
- 29 avr. 2024
- 02 mai 2024
Francqui lecture: Nut Graphs in chemistry
Colloques & séminaires - 14 mai 2024
- 15 mai 2024
Dante en Belgique francophone - Colloque international
Colloques & séminaires - 19 juin 2024