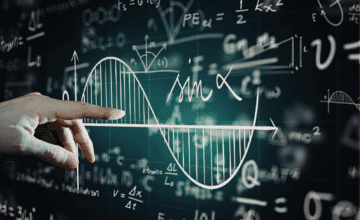Nouveau post-doc dans le service de Physique Nucléaire et Subnucléaire.
L’institut a accepté de financer les trois prochains mois de travail de Cyrille Chevalier, diplômé docteur à l’UMONS en juin dernier, afin qu’il puisse poursuivre ses travaux sur les boules de glu. Ces états prédits par la QCD se sont avérés relativement insaisissables expérimentalement. Davantage de données théoriques, incluant celles que Cyrille se propose de calculer, sont nécessaires pour démêler cette situation.
Le monde microscopique est communément morcelé en différentes échelles imbriquées les unes dans les autres. Les molécules sont faites d’atomes, eux-mêmes faits d’électrons et d’un noyau, lui-même constitué de protons et de neutrons. À ce jour, les composants connus les plus fondamentaux de la matière appartiennent à une échelle encore inférieure puisqu’ils structurent eux-mêmes protons et neutrons. La théorie moderne régissant la dynamique de ces particules, nommées les quarks, s’intitule la chromodynamique quantique. Cette théorie de champ, particulièrement ardue à manipuler, associe à ses composants une propriété intrinsèque, appelée couleur, qui affecte la façon dont ils interagissent. En un sens, la couleur est au quark ce que la charge est à une particule sensible à l’interaction électromagnétique. Formellement, l’interaction de couleur est décrite comme médiée par l’échange d’un nouveau type de particule appelé gluon. Propriété unique des gluons, ces derniers sont eux-mêmes colorés et peuvent donc également interagir pour former des agrégats nommés boules de glu. Malheureusement, l’observation expérimentale de ces particules uniques, prédites depuis plus de cinquante ans, ne fait toujours pas l’objet d’un consensus scientifique établi. Ce fait s’explique par le manque d’études théoriques précises définissant les propriétés attendues pour de telles particules. Une telle incertitude théorique rend l’interprétation des résultats expérimentaux délicate.
C’est dans ce cadre que le projet mené par Cyrille apporte sa contribution. Comme mentionné plus haut, manipuler la chromodynamique quantique est une tâche ardue et, à ce jour, en extraire des informations précises s’avère souvent difficile. Les physiciens doivent alors se tourner vers différentes techniques de résolution, plus ou moins approchées et plus ou moins phénoménologiques. La pluralité des techniques est alors un atout : plusieurs approches indépendantes s’accordant sur une propriété attendue lui donnent plus de crédit. Parmi ces techniques, mentionnons les approches constituantes, des modèles phénoménologiques dans lesquels les boules de glu sont décrites comme des systèmes de deux gluons s’attirant mutuellement. Une dynamique est alors implémentée au moyen d’une équation de type Schrödinger utilisant un potentiel inspiré par la chromodynamique. Difficulté supplémentaire, le gluon étant prédit comme une particule non massive, la description de ses degrés de liberté de spin requiert l’emploi du formalisme d’hélicité. Une fois tous les ingrédients combinés correctement et les équations résolues, ce modèle de boule de glu fournit les spins, masses et parités attendues pour celles-ci. En investiguant davantage, le modèle peut aussi être utilisé pour prédire d’autres propriétés, telles que les canaux de désintégration ou certains facteurs de forme. Ces données peuvent alors être comparées à celles obtenues au moyen d’autres approches, renforçant ainsi l’état de l’art théorique quant à ce qui est attendu d’une telle particule.
Le projet financé propose de peaufiner la méthode susmentionnée pour permettre l’étude de ces propriétés d’un grand intérêt expérimental. En particulier, il sera nécessaire d’adapter les techniques de calcul déjà existantes à l’emploi du formalisme d’hélicité. Cette tâche, bien que complexe, devrait contribuer à lever le voile qui recouvre encore ces insaisissables boules de glu, dont la prédiction théorique suscite l’intérêt depuis maintenant une bonne cinquantaine d’années.